
Le droit à l’image et le RGPD partagent un objectif commun : protéger la vie privée et les données personnelles des individus. En 2025, les règles se sont renforcées, notamment avec la loi du 19 février 2024 qui encadre plus strictement la diffusion d’images des enfants. Cet article fait le point sur les obligations, les bonnes pratiques et les nouveautés à connaître pour concilier communication visuelle et conformité juridique.
L’image : une donnée personnelle à part entière
Depuis l’entrée en vigueur du RGPD, toute image d’une personne identifiable est considérée comme une donnée à caractère personnel. Sa collecte, son traitement et sa diffusion sont donc soumis aux principes fondamentaux du règlement européen : licéité, transparence, finalité déterminée et sécurité.
Le traitement d’une image nécessite une base légale claire — le plus souvent, le consentement explicite et éclairé de la personne concernée. Ce consentement doit être libre, spécifique, informé et univoque, et la personne doit pouvoir le retirer à tout moment.
Les nouvelles dispositions légales en 2024-2025
La loi n° 2024-120 du 19 février 2024, désormais pleinement applicable, marque une évolution importante. Elle vise à protéger les mineurs contre la diffusion non maîtrisée de leurs images, particulièrement sur les réseaux sociaux. Ce texte permet notamment au juge aux affaires familiales d’interdire à un parent de publier des contenus relatifs à un enfant sans l’accord de l’autre parent et renforce le rôle de la CNIL en cas de manquement.
Ces mesures traduisent la prise de conscience croissante des dangers liés à la surmédiatisation des mineurs (« sharenting ») et à la diffusion non consentie de leurs images.
Le rôle central du consentement
Obtenir le consentement de la personne photographiée n’est pas une formalité administrative, mais une exigence juridique et éthique. Le document de consentement doit indiquer :
Le contexte et les finalités du traitement (promotion, communication interne, publication en ligne…)
Les supports de diffusion (site web, réseaux sociaux, presse)
La durée d’exploitation autorisée
Les possibilités de retrait ou de suppression de l’image
Ce document doit être conservé pendant toute la durée d’utilisation de la photo comme preuve de conformité. En cas de doute, mieux vaut renouveler le consentement ou anonymiser l’image avant diffusion.
La responsabilité des organisations et des particuliers
Les entreprises, associations et créateurs de contenu sont considérés comme responsables de traitement au sens du RGPD. Elles doivent garantir la sécurité et la confidentialité des images collectées, notamment en limitant l’accès, en évitant la géolocalisation visible et en supprimant les métadonnées sensibles.
Les particuliers, y compris les parents publiant des photos d’enfants, sont également concernés : la loi prévoit désormais des sanctions pouvant aller jusqu’à des amendes et des retraits forcés de contenus si les droits des personnes sont violés.
Bonnes pratiques pour rester conforme
Rédiger une politique claire sur l’utilisation des images.
Obtenir le consentement écrit avant toute diffusion.
Informer les personnes de leur droit de retrait.
Vérifier les paramètres de confidentialité des réseaux sociaux.
Supprimer régulièrement les contenus obsolètes ou sensibles.
Respecter le RGPD et le droit à l’image, c’est protéger à la fois les autres et soi-même. En 2025, la vigilance reste la clé d’une utilisation responsable des visuels, à la croisée du droit, de la technologie et de l’éthique.

Dans le cadre de la prise de photos, notamment pour un usage professionnel ou commercial, il est essentiel d’obtenir un consentement éclairé des personnes photographiées. Ce consentement protège vos droits ainsi que ceux des personnes concernées, tout en respectant le cadre légal de la protection des données personnelles et du droit à l’image.
Qu’est-ce que le consentement éclairé ?
Le consentement éclairé signifie que la personne dont l’image est capturée comprend précisément à quoi elle consent. Cela inclut la nature de l’utilisation des photographies, la durée de leur exploitation, les supports de communication concernés, ainsi que les droits qu’elle conserve ou cède.
Ce consentement doit être libre, spécifique, informé et univoque, conformément au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).
Pourquoi est-il important d’obtenir un consentement éclairé ?
Prévenir les litiges : un accord clair évite des conflits ultérieurs liés à un usage non autorisé ou détourné.
Respecter la vie privée : chaque individu a droit à la maîtrise sur son image.
Conformité légale : le non-respect peut entraîner des sanctions importantes, notamment en matière de protection des données.
Étapes pour obtenir un consentement éclairé valide
Informer la personne avant la prise de photo
expliquez clairement pourquoi la photo est prise, à quelles fins elle sera utilisée, et pendant combien de temps elle sera exploitée.
Rédiger un document de consentement adapté
un formulaire écrit, précis et détaillé doit être mis à disposition, rappelant les droits de la personne, l’usage des images, et les possibilités de retrait du consentement.
Faire signer le formulaire avant la séance photo
la signature prouve que la personne a compris et accepté les conditions d’utilisation.
Conserver les preuves de consentement
gardez une copie du formulaire signé, ainsi que toute correspondance ou preuve audiovisuelle attestant de la situation d’information.
Respecter les droits post-consentement
la personne peut retirer son consentement à tout moment ; vous devez alors cesser l’utilisation des images selon les modalités prévues.
Conseils pratiques supplémentaires
Utilisez un langage simple, évitez le jargon juridique.
Prévoyez aussi un consentement pour les mineurs, signé par leurs représentants légaux.
Expliquez les droits d’accès, de modification, et de suppression des images.
En cas de photos de groupe, rappelez les possibilités pour les individus de s’opposer.
Adopter une démarche rigoureuse pour obtenir un consentement éclairé pour vos photos valorise votre professionnalisme, rassure vos clients et respecte scrupuleusement la législation en vigueur.

La reconnaissance faciale s’est imposée en quelques années comme l’une des technologies les plus controversées au monde. Entre promesse sécuritaire, prouesse technologique et menace pour la vie privée, elle cristallise des enjeux éthiques et juridiques majeurs. En 2025, les avancées de l’intelligence artificielle et les nouvelles régulations européennes modifient profondément les contours de son utilisation.
Une technologie en pleine maturité
Portée par des algorithmes d’IA de plus en plus puissants, la reconnaissance faciale atteint désormais des taux de précision inédits. Grâce à l’apprentissage profond et aux réseaux neuronaux convolutifs, les systèmes peuvent identifier une personne malgré les changements d’angle, de luminosité ou de couvre-visage. Ces performances ont favorisé son adoption dans la sécurité, l’accès aux locaux, la gestion des flux, ou encore les paiements sans contact.
L’essor des technologies dites « multimodales », combinant visage, empreintes digitales et reconnaissance vocale, renforce la fiabilité des systèmes mais multiplie aussi la quantité de données biométriques sensibles en circulation. Des innovations comme les détections d’émotions ou de vivacité permettent de contrer les tentatives d’usurpation, mais elles posent de nouvelles questions de respect de la vie privée.
Un cadre légal en évolution rapide
En Europe, la législation s’adapte à cette croissance vertigineuse. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle (AI Act), adopté en mars 2024, a classé la reconnaissance faciale en temps réel comme une technologie à « risque inacceptable » lorsqu’elle est utilisée à des fins de surveillance policière. Les États membres doivent désormais interdire son emploi dans l’espace public, sauf exceptions strictement encadrées (enquêtes antiterroristes ou recherche de personnes disparues).
Le droit européen impose également le principe de proportionnalité : tout traitement biométrique doit être nécessaire, justifié et accompagné de garanties spécifiques. La CNIL en France veille à ce que ces technologies respectent le RGPD, notamment en matière de consentement, de durée de conservation et de sécurité des données.
Des tensions entre sécurité et libertés
L’un des débats majeurs concerne l’équilibre entre la protection des citoyens et le respect de leurs libertés fondamentales. En France, la reconnaissance faciale n’est actuellement autorisée que de manière rétrospective, dans le cadre d’enquêtes judiciaires, notamment via le fichier TAJ (Traitement des Antécédents Judiciaires). Cependant, l’infrastructure technique permettant un usage en temps réel existe déjà, notamment avec les 90 000 caméras de vidéosurveillance présentes sur la voie publique.
La montée en puissance d’outils comme PimEyes – capables d’identifier un individu à partir d’une simple photo en ligne – montre à quel point la frontière entre protection et surveillance devient floue. Ces pratiques amènent à repenser notre rapport à la sécurité numérique, à la réputation en ligne et au consentement.
Les enjeux éthiques et sociétaux
La reconnaissance faciale questionne la notion même d’identité numérique. Qui contrôle les images et les modèles d’apprentissage ? Comment garantir la non-discrimination dans les algorithmes ? Ces interrogations nourrissent le débat public. Les risques d’abus, particulièrement dans les régimes autoritaires, rappellent que la technologie peut renforcer autant qu’elle menacer les libertés.
L’Union européenne, tout comme plusieurs ONG, plaide pour une approche centrée sur les droits fondamentaux : développement éthique des algorithmes, transparence sur les traitements, sensibilisation du public et droit à l’effacement biométrique. Ces principes visent à trouver le juste équilibre entre innovation technologique et respect de la dignité humaine.
En 2025, la reconnaissance faciale se situe à un carrefour historique. Son avenir dépendra non seulement des progrès de l’intelligence artificielle, mais surtout de la capacité des législateurs et des citoyens à encadrer son usage de manière responsable et démocratique.
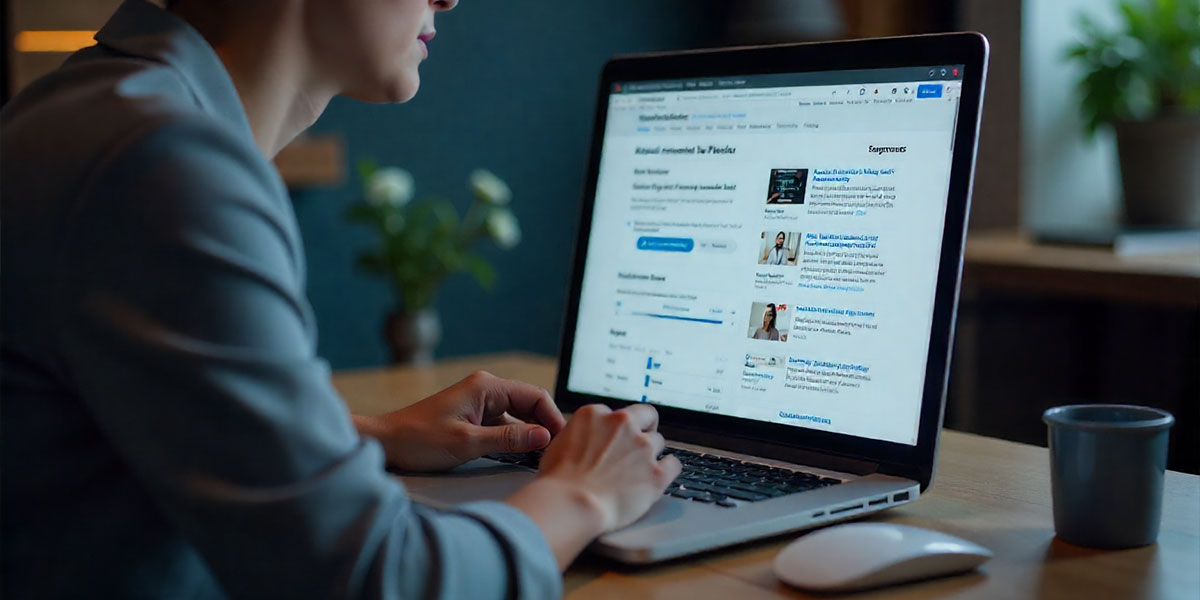
Diffuser des images en ligne est devenu un réflexe quotidien, que ce soit sur les réseaux sociaux, un blog, un site internet ou dans un cadre professionnel. Cependant, cette pratique peut rapidement donner lieu à des litiges juridiques, ou porter atteinte à la réputation ou à la vie privée des personnes concernées. Voici les 5 erreurs majeures à éviter absolument pour diffuser des images en toute sécurité et conformité.
1. Diffuser une photo sans le consentement de la personne concernée
Le droit à l’image protège toute personne identifiable sur une photo. Il est interdit de diffuser une image sans son accord, même si la photo a été prise dans un lieu public. L’absence de consentement peut entraîner des poursuites pour atteinte à la vie privée, avec des sanctions pouvant aller jusqu’à un an de prison et 15 000 euros d’amende. Obtenir un consentement écrit et éclairé est essentiel avant toute publication.
2. Utiliser des images sans vérifier les droits d’auteur
Une image trouvée sur Internet, notamment via des moteurs de recherche comme Google, n’est pas forcément libre de droits. La plupart des images sont automatiquement protégées par le droit d’auteur dès leur création. Utiliser une image sans autorisation explicite de l’auteur constitue une contrefaçon passible de sanctions importantes, y compris des demandes de dédommagements. Il est donc crucial d’utiliser des images issues de banques d’images avec licences claires ou d’obtenir une autorisation écrite.
3. Publier des images intimes sans précautions strictes
La diffusion d’images à caractère intime sans consentement est une infraction grave, souvent désignée par le terme de revenge porn. Cela cause un traumatisme important à la victime et est réprimé par la loi avec des poursuites au pénal. Ce type de diffusion doit être strictement encadré et toute image intime ne doit jamais être diffusée sans l’accord explicite de la personne concernée.
4. Négliger la gestion des données personnelles associées aux images
Les photos numériques comportent souvent des métadonnées comme la localisation GPS, la date et l’heure. Ces données peuvent révéler des informations sensibles sur les personnes, surtout sur les enfants, et ainsi nuire à leur vie privée ou à leur sécurité. Il est conseillé de supprimer ces métadonnées avant diffusion et de penser à l’impact durable des images publiées en ligne.
5. Omettre de mentionner clairement les conditions de diffusion et d'utilisation
Il est important d’informer clairement les personnes photographiées sur les finalités de l’utilisation des images : supports concernés, durée de diffusion, cession éventuelle à des tiers, etc. Sans cette transparence, le consentement ne peut être considéré comme éclairé, ce qui pose un risque légal et éthique. Formaliser cette information via un document écrit permet d’éviter bien des conflits.
En évitant ces erreurs, vous protégez les droits des individus, vous évitez des risques juridiques et vous maintenez une relation de confiance avec vos interlocuteurs et publics. Pour toute utilisation professionnelle ou publique, une vigilance accrue est indispensable afin de respecter la législation en vigueur et les principes fondamentaux du droit à l’image en France.
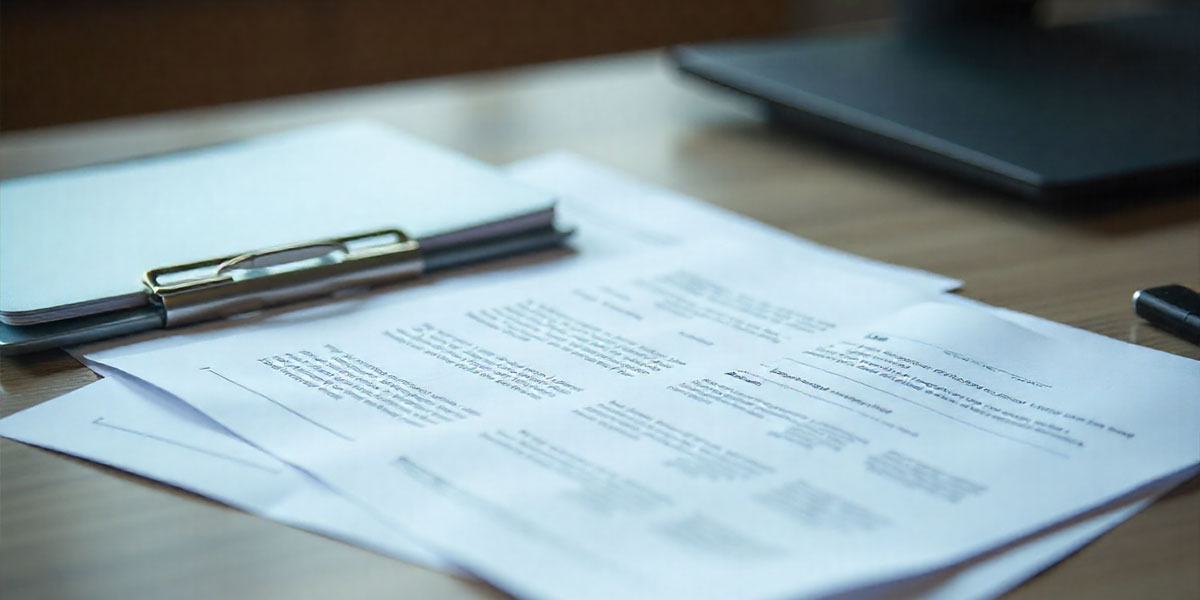
okPics est une solution numérique complète – à la fois un logiciel applicatif en ligne (SaaS) et une application mobile (Android / iOS) – conçue pour révolutionner la gestion des autorisations de droit à l'image. Imaginez un outil qui simplifie l'obtention, le suivi et la protection du consentement pour l'utilisation des images.

